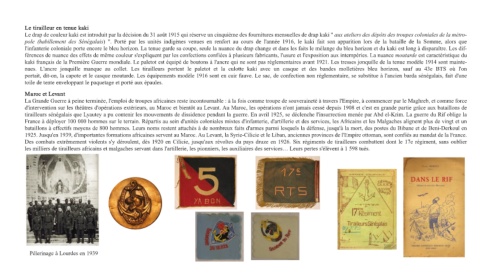Page 35 - Force Noire
P. 35
Catalogue Force Noire 64p 30/07/07 10:41 Page 33
n
t
r
i
e
t
e
r
l
u
e
i
a
l
k
k
a
e
n
e
L Le tirailleur en tenue kaki i
u
Le drap de couleur kaki est introduit par la décision du 31 août 1915 qui réserve un cinquième des fournitures mensuelles de drap kaki " aux ateliers des dépôts des troupes coloniales de la métro-
pole (habillement des Sénégalais) ". Porté par les unités indigènes venues en renfort au cours de l'année 1916, le kaki fait son apparition lors de la bataille de la Somme, alors que
l'infanterie coloniale porte encore le bleu horizon. La tenue garde sa coupe, seule la nuance du drap change et dans les faits le mélange du bleu horizon et du kaki est long à disparaître. Les dif-
férences de nuance des effets de même couleur s'expliquent par les confections confiées à plusieurs fabricants, l'usure et l'exposition aux intempéries. La nuance moutarde est caractéristique du
kaki français de la Première Guerre mondiale. Le paletot est équipé de boutons à l'ancre qui ne sont pas réglementaires avant 1921. Les tresses jonquille de la tenue modèle 1914 sont mainte-
nues. L'ancre jonquille manque au collet. Les tirailleurs portent le paletot et la culotte kaki avec un casque et des bandes molletières bleu horizon, sauf au 43e BTS où l'on
portait, dit-on, la capote et le casque moutarde. Les équipements modèle 1916 sont en cuir fauve. Le sac, de confection non réglementaire, se substitue à l'ancien barda sénégalais, fait d'une
toile de tente enveloppant le paquetage et porté aux épaules.
e
n
v
a
o
c
r
M Maroc et Levant t
a
L
t
e
La Grande Guerre à peine terminée, l'emploi de troupes africaines reste incontournable : à la fois comme troupe de souveraineté à travers l'Empire, à commencer par le Maghreb, et comme force
d'intervention sur les théâtres d'opérations extérieurs, au Maroc et bientôt au Levant. Au Maroc, les opérations n'ont jamais cessé depuis 1908 et c'est en grande partie grâce aux bataillons de
tirailleurs sénégalais que Lyautey a pu contenir les mouvements de dissidence pendant la guerre. En avril 1925, se déclenche l'insurrection menée par Abd el-Krim. La guerre du Rif oblige la
France à déployer 100 000 hommes sur le terrain. Répartis au sein d'unités coloniales mixtes d'infanterie, d'artillerie et des services, les Africains et les Malgaches alignent plus de vingt et un
bataillons à effectifs moyens de 800 hommes. Leurs noms restent attachés à de nombreux faits d'armes parmi lesquels la défense, jusqu'à la mort, des postes du Bibane et de Beni-Derkoul en
1925. Jusqu'en 1939, d'importantes formations africaines servent au Maroc. Au Levant, la Syrie-Cilicie et le Liban, anciennes provinces de l'Empire ottoman, sont confiés au mandat de la France.
Des combats extrêmement violents s'y déroulent, dès 1920 en Cilicie, jusqu'aux révoltes du pays druze en 1926. Six régiments de tirailleurs combattent dont le 17e régiment, sans oublier
les milliers de tirailleurs africains et malgaches servant dans l'artillerie, les pionniers, les auxiliaires des services… Leurs pertes s'élèvent à 1 598 tués.
Pélerinage à Lourdes en 1939